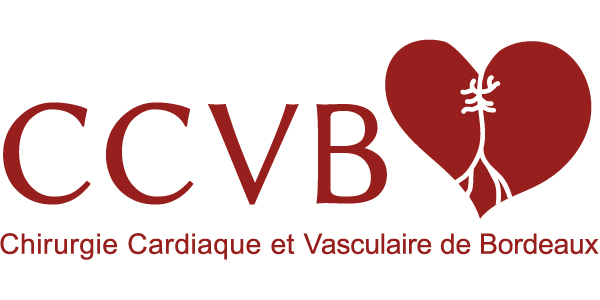top of page
NOTRE ÉQUIPE RÉPOND À TOUTES VOS QUESTIONS
Vous vous posez des questions sur une intervention, un diagnostic ou un traitement évoqué par votre médecin ? Cette page regroupe les réponses aux questions les plus fréquentes de nos patients concernant les principales pathologies prises en charge par nos équipes de chirurgie cardiaque et vasculaire à la Clinique Saint-Augustin de Bordeaux.
-
Quels sont les risques d’une chirurgie coronaire ?Comme toute intervention cardiaque, le pontage comporte des risques (saignement, infection, troubles du rythme, AVC), mais ils sont aujourd’hui bien maîtrisés. L’évaluation préopératoire permet d’anticiper les risques spécifiques à chaque patient.
-
Peut-on vivre normalement après un pontage coronarien ?Oui, la plupart des patients reprennent une vie normale après l’intervention, avec une amélioration nette de la qualité de vie et des symptômes. Une rééducation cardiaque et une hygiène de vie adaptée sont indispensables pour assurer la longévité des résultats.
-
Combien de temps dure l’intervention de pontage coronarien ?L’intervention dure en moyenne 3 à 3h30, selon le nombre de pontages à réaliser et les caractéristiques du patient. Elle se déroule sous anesthésie générale, avec une circulation extracorporelle dans la plupart des cas.
-
En quoi consiste un pontage coronarien ?Le pontage coronarien est une opération qui crée un chemin alternatif au flux sanguin en contournant les artères bouchées. Le chirurgien utilise une artère ou une veine du patient (souvent l’artère mammaire interne ou la veine saphène) pour réaliser ce "pont".
-
Quelles sont les artères utilisées pour un pontage coronarien ?Les artères mammaires internes (gauche et droite) sont les plus fréquemment utilisées car elles offrent une excellente durabilité. La veine saphène, prélevée sur la jambe, est également employée, notamment lorsque plusieurs pontages sont nécessaires.
-
Quelle est la différence entre angioplastie et pontage ?L’angioplastie coronaire est un geste non chirurgical, souvent réalisé en urgence, qui consiste à dilater l’artère bouchée avec un ballon, puis à poser un stent. Le pontage est une intervention chirurgicale plus invasive, mais parfois plus durable, indiquée dans les cas complexes ou multitronculaires.
-
Qu’est-ce que la chirurgie coronaire et quand est-elle indiquée ?La chirurgie coronaire consiste à rétablir la circulation sanguine dans les artères du cœur rétrécies ou obstruées, le plus souvent par un pontage aorto-coronarien. Elle est indiquée en cas de rétrécissements sévères non accessibles à l’angioplastie ou lors de maladie coronarienne étendue.
-
Combien de temps reste-t-on hospitalisé après un pontage ?La durée moyenne d’hospitalisation est de 7 à 10 jours. Elle comprend la surveillance post-opératoire en soins intensifs, puis la reprise progressive de l’autonomie avant le retour à domicile ou en centre de rééducation cardiovasculaire.
-
Quels sont les signes qui peuvent conduire à une chirurgie coronaire ?Un pontage peut être envisagé chez les patients souffrant d’angine de poitrine (angor), de douleurs thoraciques à l’effort, de dyspnée inexpliquée, ou après un infarctus. Une coronarographie préalable permet d’évaluer la sévérité des lésions coronaires.
-
Quelle est la durée de vie d’un pontage aorto-coronarien ?Les pontages artériels, comme ceux réalisés avec les artères mammaires, ont une excellente durée de vie, souvent supérieure à 15–20 ans. Les pontages veineux ont une durée plus variable, d’environ 8 à 12 ans, en fonction du mode de vie et des facteurs de risque.
-
Qu’est-ce qu’une fistule artério-veineuse ?C’est une connexion chirurgicale entre une artère et une veine, généralement au niveau du bras. Cette fistule permet à la veine de se dilater et de supporter les ponctions nécessaires à la dialyse à long terme.
-
Combien de temps faut-il attendre après la création d’une fistule ?Une fistule doit "mûrir" avant de pouvoir être utilisée. Ce délai varie selon les patients mais dure en moyenne de 4 à 8 semaines. Une surveillance clinique et échographique permet de juger de sa bonne évolution.
-
Que faire si les veines ne permettent pas la création d’une fistule ?Lorsque les vaisseaux ne sont pas utilisables, une fistule avec prothèse (PTFE) peut être envisagée. En cas d’urgence, un cathéter central temporaire est mis en place, mais il reste une solution transitoire.
-
L’intervention chirurgicale est-elle douloureuse ?Non. Elle est réalisée sous anesthésie locale ou loco-régionale, en ambulatoire. Une gêne ou une légère douleur peuvent apparaître dans les jours suivants mais sont généralement bien tolérées.
-
Qui décide du type d’abord vasculaire à réaliser ?La décision est prise en concertation entre le néphrologue, le chirurgien vasculaire et le patient, en fonction de l’anatomie vasculaire, du stade de la maladie rénale, et des antécédents médicaux.
-
Pourquoi faut-il créer un abord vasculaire avant de débuter la dialyse ?Un abord vasculaire est indispensable pour assurer un débit sanguin suffisant pendant l’hémodialyse. Il permet de connecter la circulation du patient à la machine d’épuration, en toute sécurité et de façon répétée.
-
Peut-on refaire une fistule si la première ne fonctionne plus ?Oui, il est possible de créer une nouvelle fistule sur un autre site du bras ou de l’avant-bras. D’où l’importance de préserver le capital veineux en évitant les perfusions ou prises de sang sur les bras à risque.
-
Quels sont les risques possibles après la création d’un abord de dialyse ?Les complications peuvent inclure la thrombose (caillot dans la veine), la sténose (rétrécissement du vaisseau), ou une mauvaise maturation. Ces situations peuvent nécessiter une réintervention ou une angioplastie.
-
Comment surveille-t-on une fistule après l’opération ?Le chirurgien vasculaire ou le néphrologue contrôle régulièrement la maturation de la fistule par examen clinique et échographie. Un suivi est également assuré tout au long de l’utilisation en dialyse.
-
Est-ce que toutes les personnes en dialyse ont une fistule ?La majorité des patients en hémodialyse ont une fistule. Certains utilisent une prothèse ou un cathéter selon leur situation médicale, mais la fistule native reste la solution la plus durable et sécurisée.
-
Est-ce que la chirurgie des varices est prise en charge par la sécurité sociale ?Oui, dès lors que les varices sont responsables d’une insuffisance veineuse avérée, avec des symptômes ou des complications. Les actes esthétiques isolés, comme le traitement des varicosités sans gêne fonctionnelle, ne sont généralement pas remboursés.
-
Quelle est la différence entre laser veineux et stripping ?Le laser endoveineux est une technique mini-invasive qui traite la veine malade de l’intérieur sans la retirer. Le stripping est une chirurgie plus classique qui enlève la veine. Le choix dépend du type de varices, de l’anatomie veineuse et des préférences du patient.
-
Quelle est la durée d’arrêt de travail après une chirurgie veineuse ?La durée dépend du type de geste et de l’activité professionnelle du patient. Elle varie de 2 à 15 jours en moyenne. Pour un traitement au laser ou une phlébectomie, la reprise peut être rapide, parfois en 48 à 72 heures.
-
Les varices peuvent-elles revenir après l’intervention ?Oui, il peut y avoir des récidives, en particulier si la maladie veineuse est évolutive. Le suivi post-opératoire et le respect des recommandations (compression, activité physique, contrôle des facteurs de risque) limitent ce risque.
-
Est-ce que toutes les varices doivent être opérées ?Non. Le traitement dépend de la gêne ressentie, de l’évolution des symptômes et du résultat de l’écho-Doppler. Certaines varices peuvent être traitées par sclérothérapie ou compression, d’autres nécessitent une intervention chirurgicale ou endoveineuse.
-
Peut-on traiter les deux jambes en même temps ?Oui, cela est possible selon l’étendue des varices et la technique utilisée. Dans certains cas, un traitement en deux temps est proposé pour optimiser les résultats et favoriser une récupération plus confortable.
-
Quelle est la place des bas de contention dans le traitement des varices ?Les bas ou chaussettes de compression sont souvent prescrits avant ou après une intervention pour soulager les symptômes et améliorer le retour veineux. Ils ne traitent pas les varices mais constituent une mesure efficace de soutien.
-
Est-ce que la chirurgie des varices est douloureuse ?Les techniques actuelles, comme le laser ou la phlébectomie, sont peu douloureuses et réalisées en ambulatoire sous anesthésie locale ou loco-régionale. Des douleurs modérées peuvent persister quelques jours mais sont bien soulagées par des antalgiques simples.
-
Quand faut-il consulter un spécialiste pour des varices ?Il est recommandé de consulter en cas de sensation de jambes lourdes, douleurs, gonflements, varices visibles ou antécédents familiaux. Une évaluation précoce permet d’éviter l’aggravation de l’insuffisance veineuse et ses complications.
-
Quelles sont les complications possibles d’une chirurgie veineuse ?Elles sont rares mais peuvent inclure hématomes, saignements, infections locales ou troubles de la sensibilité. Les complications graves comme la phlébite sont exceptionnelles, notamment grâce au port de bas de compression et à la mobilisation précoce.
-
Quelle est la différence entre chirurgie hybride et chirurgie mini-invasive ?La chirurgie mini-invasive limite l’ouverture chirurgicale, mais reste souvent un geste unique (soit ouvert, soit endovasculaire). La chirurgie hybride combine volontairement les deux techniques, parfois dans des zones différentes, pour optimiser les résultats.
-
Dans quels cas a-t-on recours à une chirurgie hybride ?La chirurgie hybride est utilisée pour des anévrismes complexes de l’aorte, des dissections aortiques, ou des lésions multisegmentaires nécessitant une revascularisation à plusieurs niveaux. Elle permet de traiter en une seule intervention ce qui nécessiterait autrement plusieurs opérations.
-
Qu’est-ce qu’une salle hybride au bloc opératoire ?Une salle hybride est un bloc opératoire de dernière génération, combinant un environnement chirurgical stérile à un plateau d’imagerie de haute précision. Elle permet de réaliser des gestes de radiologie interventionnelle en même temps que des actes chirurgicaux.
-
La chirurgie hybride est-elle plus risquée que les autres interventions ?Au contraire, elle permet souvent de réduire les risques en évitant des chirurgies plus lourdes ou répétées. Elle nécessite toutefois une expertise pointue et une coordination parfaite entre les équipes pour garantir sécurité et efficacité.
-
Qu’est-ce que la chirurgie hybride en pathologie vasculaire ou cardiaque ?La chirurgie hybride associe, au cours d’un même temps opératoire, une technique chirurgicale classique (ouverte) et une procédure endovasculaire (mini-invasive). Elle est indiquée pour traiter certaines pathologies complexes, notamment de l’aorte thoracique ou abdominale.
-
Quels sont les avantages d’une approche hybride pour le patient ?L’approche hybride permet de limiter les traumatismes chirurgicaux, de raccourcir le temps opératoire, et de réduire les risques liés à plusieurs interventions séparées. Elle offre une prise en charge sur mesure, adaptée à l’anatomie et à l’état général du patient.
-
Quelles sont les pathologies traitées par chirurgie hybride ?La chirurgie hybride est indiquée notamment dans : – les anévrismes étendus de l’aorte thoraco-abdominale, – les dissections aortiques, – certaines lésions artérielles périphériques, – les sténoses multiples, – ou des revascularisations après échec de techniques isolées.
-
Comment se déroule une chirurgie hybride ?La chirurgie hybride se déroule en salle dite « hybride », équipée à la fois pour la chirurgie conventionnelle et pour l’imagerie de haute précision. Les chirurgiens peuvent ainsi combiner une ouverture ciblée avec la pose d’endoprothèses sous contrôle radiologique.
-
Quel est le suivi après une chirurgie hybride ?Le suivi dépend du type de pathologie traitée, mais associe généralement une surveillance clinique, des examens d’imagerie (scanner ou IRM), et un suivi médical multidisciplinaire. L’objectif est d’assurer la stabilité des réparations dans le temps.
-
Qui réalise une chirurgie hybride ?Ce type d’intervention est mené en collaboration étroite entre chirurgiens cardiaques et chirurgiens vasculaires. À la Clinique Saint-Augustin, ces chirurgies à 4 mains permettent de combiner les expertises au bénéfice du patient, en particulier dans les cas complexes.
-
Peut-on prévenir l’apparition d’un anévrisme de l’aorte abdominale ?On ne peut pas toujours prévenir un AAA, mais certains facteurs augmentent le risque : tabac, hypertension, antécédents familiaux. L’arrêt du tabac, le contrôle de la tension et un dépistage ciblé après 65 ans chez les hommes à risque sont essentiels.
-
Comment se décide le type de traitement à proposer ?Le choix entre chirurgie ouverte et EVAR dépend de l’anatomie de l’anévrisme, de l’état général du patient, et de la faisabilité technique du geste endovasculaire. L’objectif est d’opter pour la solution la plus sûre et la plus durable dans chaque cas.
-
Quelle est la différence entre une chirurgie ouverte et un traitement par endoprothèse ?La chirurgie ouverte consiste à remplacer le segment dilaté de l’aorte par une prothèse en Dacron, via une ouverture abdominale. Le traitement par endoprothèse (EVAR) est une technique mini-invasive, réalisée par voie fémorale, qui place une prothèse à l’intérieur de l’aorte sans l’ouvrir.
-
Quels sont les risques d’une rupture d’anévrisme abdominal ?La rupture d’un AAA est une urgence médicale grave avec un taux de mortalité très élevé. Elle peut entraîner une hémorragie interne massive. D’où l’importance du dépistage et du suivi des anévrismes connus avant qu’ils n’atteignent un stade critique.
-
Quel suivi est nécessaire après la pose d’une endoprothèse aortique ?Un suivi régulier est indispensable après EVAR, avec des contrôles par scanner ou échographie pour vérifier la bonne position de la prothèse et dépister d’éventuelles fuites (endofuites) ou déplacements. Ce suivi est à vie.
-
Qu’est-ce qu’un anévrisme de l’aorte abdominale ?Un anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) est une dilatation anormale de la partie de l’aorte située dans l’abdomen. Cette fragilité de la paroi artérielle peut évoluer silencieusement mais expose à un risque de rupture potentiellement fatal.
-
Quelle est la durée de l’hospitalisation après traitement d’un anévrisme ?Après une chirurgie ouverte, l’hospitalisation dure généralement 7 à 10 jours. En cas de traitement par endoprothèse, la durée est souvent réduite à 2 à 4 jours, sous réserve d’absence de complication et d’un bon état général du patient.
-
Comment détecte-t-on un anévrisme de l’aorte abdominale ?Le diagnostic repose sur une échographie abdominale, un examen simple, non invasif et fiable. En cas d’anévrisme avéré, un angioscanner est souvent réalisé pour préciser la taille, la forme et la localisation avant toute décision thérapeutique.
-
À partir de quelle taille un anévrisme doit-il être opéré ?Une intervention est généralement proposée lorsque l’anévrisme dépasse 5 cm chez la femme et 5,5 cm chez l’homme, ou en cas de croissance rapide (> 1 cm par an). Une surveillance régulière est mise en place en dessous de ces seuils.
-
Quels sont les symptômes d’un anévrisme de l’aorte abdominale ?La plupart des AAA sont asymptomatiques. Lorsqu’ils deviennent symptomatiques, ils peuvent provoquer des douleurs abdominales ou lombaires, pulsatiles et persistantes. La rupture se manifeste par une douleur brutale et un état de choc : c’est une urgence vitale.
-
Quel suivi est nécessaire après une chirurgie de la carotide ?Un suivi régulier par échographie-Doppler est indispensable pour surveiller la perméabilité de l’artère opérée et dépister une éventuelle récidive. Un traitement médical (antiagrégants, statines) et une hygiène de vie adaptée sont également essentiels à long terme.
-
À partir de quel degré de sténose faut-il envisager une chirurgie ?Une chirurgie est généralement indiquée en cas de sténose serrée (> 70 %) chez un patient symptomatique. Elle peut aussi être proposée en cas de sténose asymptomatique très évoluée chez un patient à faible risque opératoire.
-
Combien de temps dure l’hospitalisation pour une chirurgie carotidienne ?L’intervention nécessite généralement une hospitalisation de 3 à 5 jours. Elle peut être réalisée sous anesthésie générale ou locorégionale, avec un suivi post-opératoire attentif pour détecter toute complication neurologique précoce.
-
Qu’est-ce qu’une sténose carotidienne ?La sténose carotidienne correspond à un rétrécissement de l’artère carotide, souvent causé par l’accumulation de plaques d’athérome. Elle peut réduire l’apport sanguin au cerveau et augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC).
-
Existe-t-il une alternative non chirurgicale à l’endartériectomie ?Oui, la dilatation par ballon et la pose d’un stent peuvent être envisagées chez certains patients à haut risque chirurgical. Cette technique, appelée angioplastie carotidienne, reste cependant réservée à des indications bien spécifiques.
-
Quels sont les symptômes d’une sténose carotidienne ?La sténose carotidienne est souvent asymptomatique. Lorsqu’elle devient symptomatique, elle peut provoquer des troubles passagers du langage, de la vision ou de la motricité d’un côté du corps — signes d’un AIT ou d’un AVC en cours.
-
Quels sont les risques d’une sténose de la carotide non traitée ?Une sténose carotidienne non prise en charge peut entraîner un AVC, transitoire (AIT) ou permanent. Le risque est plus élevé si la sténose est serrée (généralement > 70 %) ou si le patient a déjà présenté des symptômes neurologiques.
-
L’intervention sur la carotide est-elle dangereuse ?Comme toute chirurgie vasculaire, l’endartériectomie comporte des risques (AVC peropératoire, hématome, lésion nerveuse), mais ils sont aujourd’hui très bien maîtrisés grâce à l’expérience des équipes spécialisées et à une sélection rigoureuse des patients.
-
Qu’est-ce qu’une endartériectomie carotidienne ?L’endartériectomie carotidienne est une intervention chirurgicale qui consiste à ouvrir l’artère carotide pour en retirer la plaque d’athérome responsable du rétrécissement. L’artère est ensuite refermée, souvent avec un patch, pour éviter toute récidive.
-
Comment diagnostique-t-on une sténose de la carotide ?Le diagnostic repose sur l’échographie-Doppler cervicale, un examen simple et non invasif. En cas de sténose significative, un angioscanner ou une IRM peuvent être réalisés pour affiner l’analyse anatomique avant un éventuel geste chirurgical.
-
Quels sont les symptômes évocateurs d’une artérite des jambes ?Le principal symptôme est la claudication intermittente : une douleur dans la jambe à la marche, qui disparaît au repos. À un stade plus avancé, des douleurs au repos ou des plaies chroniques peuvent apparaître, traduisant une ischémie critique.
-
Qu’est-ce que l’artérite des membres inférieurs ?L’artérite, ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), est une maladie des artères qui irriguent les jambes. Elle est liée à l’accumulation de plaques d’athérome qui réduisent le débit sanguin, provoquant douleur et gêne à la marche.
-
Que risque-t-on si l’artérite n’est pas traitée ?Sans traitement, l’artérite peut évoluer vers une ischémie critique du membre : douleurs permanentes, ulcères, voire gangrène. À ce stade, le risque d’amputation devient réel. Une prise en charge précoce permet d’éviter ces complications graves.
-
Quelles sont les suites après une chirurgie pour artérite ?La récupération dépend du type d’intervention. Après un pontage, une hospitalisation de quelques jours est nécessaire. Une rééducation et un suivi régulier permettent d’évaluer l’efficacité du geste et de prévenir une récidive.
-
Qu’est-ce qu’un pontage fémoro-poplité ou fémoro-fémoral ?Le pontage consiste à créer un contournement chirurgical de l’artère bouchée à l’aide d’une prothèse vasculaire ou d’une veine du patient. Il peut relier l’artère fémorale à l’artère poplitée ou à l’artère controlatérale pour rétablir la circulation.
-
Quand une chirurgie est-elle nécessaire en cas d’artérite ?Une intervention est envisagée lorsque les douleurs deviennent invalidantes ou lorsqu’une ischémie sévère menace le membre. Elle peut consister en une angioplastie, un stenting ou un pontage artériel, selon la localisation et l’étendue des lésions.
-
Comment diagnostique-t-on une artérite ?Le diagnostic repose sur l’examen clinique, la mesure de l’index de pression systolique (IPS) et l’imagerie artérielle (échographie Doppler, angioscanner ou artériographie) pour localiser précisément les zones d’obstruction.
-
Peut-on prévenir l’évolution de l’artérite ?Oui, l’arrêt du tabac, la pratique d’une activité physique régulière, la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires (diabète, hypertension, cholestérol) et un traitement médical adapté peuvent ralentir la progression de la maladie.
-
Quelle est la différence entre angioplastie et chirurgie de pontage ?L’angioplastie est une méthode mini-invasive qui dilate l’artère avec un ballon, souvent associée à la pose d’un stent. Le pontage est une chirurgie plus lourde mais parfois indispensable lorsque les lésions sont longues ou trop calcifiées.
-
Quelles sont les causes de l’artérite des membres inférieurs ?Les facteurs de risque sont le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle, l’excès de cholestérol et l’âge. Ces facteurs favorisent le développement de l’athérome, qui bouche progressivement les artères des jambes.
-
Quelle est la durée habituelle d’une circulation extracorporelle ?La durée de la CEC varie selon l’intervention, allant de 45 minutes à plusieurs heures. L’équipe ajuste la durée au strict nécessaire pour limiter les effets secondaires liés au temps de circulation prolongée.
-
Existe-t-il des alternatives à la circulation extracorporelle ?Certaines chirurgies cardiaques peuvent être réalisées à cœur battant, sans recours à la CEC, notamment certains pontages coronariens. Cependant, la grande majorité des opérations complexes du cœur nécessitent une circulation extracorporelle pour garantir leur sécurité.
-
Pourquoi utilise-t-on une circulation extracorporelle pendant une chirurgie cardiaque ?La CEC est indispensable pour réaliser certaines interventions comme les pontages, les remplacements valvulaires ou les chirurgies de l’aorte. Elle assure une perfusion continue des organes tout en permettant d’arrêter le cœur pour opérer dans des conditions optimales.
-
Est-ce que le cœur est arrêté pendant la circulation extracorporelle ?Oui, dans la majorité des cas, le cœur est mis en arrêt temporaire (arrêt cardiaque contrôlé) grâce à une solution appelée cardioplégie. Cela permet de travailler sur un cœur immobile, sans risque, pendant que la machine prend le relais de sa fonction.
-
Qui surveille la circulation extracorporelle pendant l’opération ?La CEC est supervisée en temps réel par un perfusionniste spécialisé, en coordination avec le chirurgien et l’anesthésiste. Ce professionnel contrôle en permanence les paramètres de débit, d’oxygénation, de température et de pression sanguine.
-
Quels sont les effets secondaires possibles après une CEC ?Après une CEC, certains patients peuvent présenter une fatigue importante, des troubles de la mémoire transitoires ou un état inflammatoire léger. Ces effets sont généralement temporaires et pris en charge pendant l’hospitalisation.
-
La circulation extracorporelle est-elle utilisée en dehors de la chirurgie cardiaque ?Oui, la CEC peut également être utilisée dans des situations de réanimation avancée (ECMO) ou lors de certaines transplantations. Dans le cadre de la chirurgie cardiaque, elle reste toutefois son principal domaine d’application.
-
La circulation extracorporelle est-elle dangereuse ?La CEC est aujourd’hui une technique très maîtrisée et encadrée. Elle comporte certains risques (inflammation, troubles de la coagulation, atteintes neurologiques transitoires), mais ceux-ci sont devenus rares grâce à l’expertise des équipes chirurgicales et perfusionnistes.
-
Comment fonctionne la machine cœur-poumon utilisée en CEC ?La machine de circulation extracorporelle aspire le sang veineux, le filtre, l’oxygène et le réchauffe avant de le réinjecter dans l’aorte. Elle joue à la fois le rôle du cœur et des poumons, grâce à une pompe et un oxygénateur intégrés.
-
Qu’est-ce que la circulation extracorporelle en chirurgie cardiaque ?La circulation extracorporelle (CEC) est une technique qui permet de remplacer temporairement la fonction du cœur et des poumons pendant une opération. Le sang est détourné vers une machine qui l’oxygène et le réinjecte dans le corps, permettant au chirurgien d’intervenir sur un cœur immobile.
-
Quelle différence entre anévrisme et dissection aortique ?L’anévrisme est une dilatation progressive de l’aorte. La dissection est une déchirure brutale de la paroi aortique, souvent sur terrain anévrismal, qui peut entraîner une hémorragie interne grave. Certaines dissections nécessitent une chirurgie en urgence.
-
Quels sont les facteurs de risque d’anévrisme de l’aorte ?Les principaux facteurs sont l’hypertension artérielle, les antécédents familiaux, les maladies du tissu conjonctif (Marfan, Loeys-Dietz), une bicuspidie aortique, le tabagisme ou encore un âge avancé. Une surveillance ciblée peut être recommandée.
-
À partir de quel diamètre un anévrisme de l’aorte thoracique doit-il être opéré ?La chirurgie est généralement recommandée lorsque l’anévrisme dépasse 5 à 5,5 cm de diamètre, ou plus tôt en cas de croissance rapide, de symptômes, ou chez des patients à risque particulier (syndrome de Marfan, antécédents familiaux, bicuspidie aortique…).
-
Quelle est la durée d’hospitalisation après une chirurgie de l’aorte ?Après une chirurgie ouverte, l’hospitalisation dure généralement 7 jours, incluant un séjour en soins intensifs. En cas de traitement par endoprothèse, la durée peut être réduite à quelques jours, sous réserve d’évolution favorable.
-
Peut-on vivre normalement après une chirurgie de l’aorte thoracique ?Oui, après la période de convalescence, la majorité des patients retrouvent une qualité de vie satisfaisante. Un suivi régulier, une bonne gestion de la tension artérielle et une hygiène de vie adaptée sont essentiels pour prévenir toute récidive.
-
Comment se déroule la chirurgie d’un anévrisme de l’aorte thoracique ?La chirurgie consiste à remplacer le segment dilaté de l’aorte par une prothèse en Dacron. Elle se fait sous anesthésie générale, en circulation extracorporelle. Dans certains cas, une approche mini-invasive avec pose d’endoprothèse (TEVAR) est possible.
-
Quels sont les signes d’alerte d’un anévrisme de l’aorte thoracique ?La plupart des anévrismes thoraciques sont asymptomatiques. Lorsqu’ils deviennent symptomatiques, ils peuvent provoquer des douleurs thoraciques, dorsales ou interscapulaires. En cas de rupture ou de dissection, il s’agit d’une urgence vitale.
-
Quelle est la surveillance après un traitement d’anévrisme de l’aorte ?Une surveillance régulière par scanner ou IRM est indispensable après traitement, qu’il soit chirurgical ou endovasculaire, pour contrôler l’intégrité de la prothèse et détecter toute complication ou nouvelle dilatation aortique.
-
Qu’est-ce qu’un anévrisme de l’aorte thoracique ?Un anévrisme de l’aorte thoracique correspond à une dilatation anormale de l’aorte située dans la poitrine. Il s’agit d’une fragilité de la paroi artérielle qui peut évoluer silencieusement mais expose à un risque de rupture potentiellement mortel.
-
Peut-on traiter un anévrisme thoracique sans chirurgie ouverte ?Oui, certains anévrismes sont accessibles à un traitement endovasculaire (TEVAR), par mise en place d’une endoprothèse par voie fémorale, sans ouverture du thorax. Cette technique dépend de la localisation précise de l’anévrisme et de l’anatomie du patient.
-
Quel est le temps de récupération après une chirurgie valvulaire ?La convalescence dure en moyenne 3 semaines après une chirurgie conventionnelle. Une rééducation cardiaque est souvent recommandée pour favoriser la reprise des activités physiques et surveiller le bon fonctionnement de la valve implantée.
-
Est-il possible d'opérer plusieurs valves cardiaques lors d'une même intervention ?Oui, il est fréquent de traiter plusieurs valves lors d’une seule intervention si cela est nécessaire (par exemple valve mitrale et valve tricuspide). Cela permet d’optimiser la prise en charge globale du patient et de limiter les risques cumulés.
-
Comment se déroule une chirurgie valvulaire conventionnelle ?La chirurgie valvulaire classique se fait sous anesthésie générale, via une ouverture du sternum (sternotomie). Le cœur est mis au repos avec circulation extracorporelle pour permettre le remplacement ou la réparation de la valve défaillante.
-
Qu’est-ce que le traitement par MitraClip et dans quels cas est-il proposé ?Le MitraClip est une alternative mini-invasive à la chirurgie de la valve mitrale. Il est proposé à certains patients présentant une insuffisance mitrale sévère et à haut risque opératoire. L’intervention se fait par voie veineuse, sans ouverture du thorax.
-
En quoi consiste une plastie mitrale ?La plastie mitrale est une chirurgie reconstructrice de la valve mitrale. Elle permet de réparer la valve native en resserrant les feuillets ou en remplaçant l’anneau, sans avoir recours à une prothèse. C’est la solution privilégiée lorsqu’elle est techniquement réalisable.
-
Quelle est la durée de vie d’une valve cardiaque prothétique ?Les valves mécaniques ont une durée de vie très longue, mais nécessitent un traitement anticoagulant à vie. Les valves biologiques (d’origine animale) durent en moyenne 10 à 15 ans, mais n’imposent généralement pas de traitement anticoagulant prolongé.
-
Quelle est la différence entre rétrécissement aortique et insuffisance aortique ?Le rétrécissement aortique correspond à une valve aortique qui s’ouvre mal, limitant l’éjection du sang. L’insuffisance aortique désigne une valve qui fuit, laissant le sang refluer vers le cœur. Ces deux pathologies ont des mécanismes et des traitements distincts.
-
À partir de quel stade une maladie valvulaire nécessite-t-elle une opération ?Une intervention chirurgicale est envisagée lorsque la valve cardiaque altérée entraîne des symptômes (essoufflement, fatigue, œdème) ou une atteinte fonctionnelle du cœur visible à l’échographie. Même en l'absence de symptômes, certaines valvulopathies évoluées peuvent justifier une chirurgie préventive.
-
Peut-on éviter une opération en cas de valvulopathie ?Certaines valvulopathies peuvent être suivies médicalement pendant plusieurs années. Toutefois, au stade sévère, seule une intervention chirurgicale ou percutanée permet d’éviter l’évolution vers l’insuffisance cardiaque et les complications graves.
-
Quelle différence entre valve tricuspide et valve pulmonaire dans les traitements chirurgicaux ?La valve tricuspide est située entre l’oreillette et le ventricule droit, tandis que la valve pulmonaire relie le cœur aux poumons. Les pathologies de la tricuspide sont souvent réparées par plastie, celles de la pulmonaire peuvent nécessiter un remplacement, notamment dans les cas congénitaux.
bottom of page